Interview lu dans le journal L’Express.
Comblé par le succès d’Intouchables, Omar Sy s’est pourtant fait discret dans la presse. Explications d’un homme qui se méfie des pièges de la notoriété.
Omar Sy a le sourire élastique. De ceux qui s’étendent sans cesse d’une oreille à l’autre. Comme si l’acteur ne pouvait s’en empêcher. D’ailleurs, il ne peut pas. Grâce à Intouchables, le film aux 19 millions d’entrées (pour l’instant), cet acteur d’à peine 34 ans bénéficie d’une incroyable popularité, croule sous les propositions et se retrouve nommé aux Césars, catégorie meilleur acteur, dont la cérémonie se tiendra le 24 février. Donc, il sourit. Tout le temps. Notamment là, quand il arrive, couvert d’une grosse doudoune, dans la suite d’un palace parisien. Pourtant, il n’est pas fan des interviews. D’ailleurs, cet entretien est le premier qu’il accorde à la presse écrite depuis la sortie d’Intouchables. Un peu sérieux tout de même. Mais pas trop. Son rire est devenu le plus célèbre du cinéma français.
Un film au sommet du box-office, une nomination au César du meilleur acteur, une notoriété décuplée… Imaginiez-vous un instant qu’une chose pareille vous arriverait? Ou, au moins, l’espériez-vous secrètement?
Non, même pas secrètement. J’ai commencé ce métier en 1995 comme on pratique un loisir. Certains font du karaté ou du foot, d’autres vont au yoga, moi, j’allais à la radio avec Jamel Debbouze. C’était sur Radio Nova. Je jouais les faux auditeurs avec Fred Testot, [NDLR: son comparse du SAV, sur Canal +], Vincent Desagnat etMichaël Youn. Au début, j’étais là pour accompagner Jamel et puis on m’a payé pour revenir. J’avais 17 ans, j’étais lycéen et, à la fin de l’année, j’avais un bac F à passer [NDLR: l’équivalent actuel d’un bac sciences et techniques industrielles]. Je m’étais spécialisé dans le chauffage et la climatisation, histoire d’avoir un métier si j’avais dû retourner au bled, au Sénégal. Mais un mois avant l’examen, je pars au Festival de Cannes pour Le Cinéma de Jamel, sur Canal +, auquel je participais. Je n’allais tout de même pas emporter mon cartable et mes devoirs…
Vous avez donc tiré un trait sur le bac?
On m’invite au Festival de Cannes, je suis logé, on me file un scooter, je passe à la télé et on me paie! Je ne peux pas refuser! Je me disais que pour le bac je me débrouillerais. Et puis, malgré les épreuves du rattrapage, je ne l’ai pas eu. Mais ma vie était déjà ailleurs. Et pas dans la climatisation.
Vos parents n’étaient-ils pas inquiets?
Ils ont flippé comme jamais. Ils ont pris ma décision pour un coup de tête. J’étais assez studieux, j’avais des projets précis, et ils ont cru que je perdais les pédales. Comme je n’avais jamais manifesté l’envie d’être comédien, ils ne comprenaient pas cette nouvelle orientation, totalement abstraite pour eux. Ils m’ont assailli de questions: mon père, qui est magasinier, me demandait régulièrement si Canal + m’avait enfin signé un CDI…
Ils connaissaient Jamel?
Bien sûr. On a grandi dans le même quartier de Trappes [Yvelines], lui, Nicolas Anelka et moi. Mais que Jamel soit devenu comédien et Nicolas Anelka footballeur n’a surpris personne. Alors que mon parcours est complètement illogique.
Mélissa Theuriau a réalisé un documentaire, Les Trappistes [diffusé sur Canal +], qui relate cette amitié et votre passé commun dans une cité. N’aviez-vous pas peur d’être les trois arbres qui cachent la forêt?
Si, j’en avais peur. Et j’avais aussi peur de me montrer. J’avais tort. Ce qui ressort de ce documentaire, ce sont nos mamans. Tout ce que Jamel, Nicolas et moi sommes aujourd’hui, c’est grâce à elles. Trois mamans qui n’ont jamais démissionné. Leur amour, c’est de l’engrais. On parle sans cesse de la banlieue, mais les gens n’en savent pas grand-chose finalement. Je ne fais pas dans l’angélisme. Il y a du trafic, des violences…
Mais il y a aussi des gens qui triment, qui font des études, qui cravachent… Malgré cela, pas mal de nos potes ne s’en sont pas sortis. Là-bas, quand un mec dit qu’il va réussir, on le prend pour un fou ou pour un Bisounours. Vu l’environnement, c’est normal. Et pourtant, rien n’est impossible. Il faut rencontrer les bonnes personnes, celles qui tendent la main. Et croire à son rêve. Mais il faut l’avoir en tête, ce rêve.
Vous avez quitté le domicile parental à 20 ans pour habiter avec une femme. Vous avez eu quatre enfants ensemble et c’est, encore aujourd’hui, votre épouse. Par les temps qui courent, c’est exceptionnel!
C’est aussi une femme exceptionnelle. Je suis parti de chez mes parents parce que j’étais amoureux. C’est simple. J’ai toujours pris la vie simplement, d’ailleurs. Je n’ai pas le sentiment d’avoir galéré. J’ai mis un pied dans le milieu artistique et j’ai été immédiatement aspiré. Avec Fred, on a eu des moments difficiles, notamment quand on a quitté Canal + pour monter notre spectacle, en 2006. On était un peu justes financièrement. Mais cela reste des moments où j’ai beaucoup appris sur moi et qui ont cimenté notre amitié. Sur scène, je me suis aperçu que j’aimais vraiment ce métier.
En parallèle au SAV, vous avez un peu goûté au cinéma. Jusqu’à votre premier rôle important dans Nos jours heureux, d’Eric Toledano et Olivier Nakache, futurs réalisateurs d’Intouchables… Il n’y a pas de hasard.
Il n’y a effectivement pas de hasard. En fait, Eric et Olivier m’avaient déjà engagé, en 2002, sur Ces jours heureux, un court-métrage. N’ayant jamais fait de cinéma, je les ai prévenus que je n’étais pas comédien. Ils m’ont répondu qu’eux-mêmes n’étaient pas encore réalisateurs… Je les ai forcément trouvés sympas.
Avez-vous reçu beaucoup de propositions après Nos jours heureux?
Oui, pas mal. Et, grâce au confort offert par Canal +, j’en ai refusé beaucoup. Parce qu’on m’a évidemment proposé des rôles de caïds et de mecs de banlieue. Je n’avais pas envie d’aller me frotter au cinéma pour véhiculer des clichés. Pas plus que maintenant je n’ai envie d’être le Noir à la mode.
Votre agent dit que vous êtes passé d’une proposition par semaine à une dizaine aujourd’hui. Vous confirmez ?
Je confirme. Mais quand Intouchables est sorti, je n’ai rien voulu lire. Je démarrais le tournage de De l’autre côté du périph’, de David Charhon, et je voulais rester concentré. J’avais peur de perdre pied. Ce qui pouvait m’arriver de mieux à la sortie d’Intouchables, c’était de retourner immédiatement dans le concret, de me remettre au boulot. Une façon de garder les pieds sur terre. Aujourd’hui, c’est différent. J’ai demandé à mon agent de trier les propositions et de me les faire parvenir.
Il y a deux manières de gérer ce genre de triomphe. Multiplier les interviews ou, au contraire, fermer les portes et ne plus communiquer. Pourquoi avoir opté pour le second choix ?
C’est comme si j’avais entendu un truc du genre: « Ce qui se passe t’appartient. Tu n’as pas à le partager. » Plus exactement, je le partage, mais avec mes producteurs, mon agent, ma femme, ma famille. Je n’ai aucune envie de me répandre dans les médias. Et puis, c’est très difficile d’en parler dans le feu de l’action. Je vais dire quoi? Que je suis content? Oui, et alors? A quoi ça sert? Autant en profiter. Vivre le bonheur plutôt que le crier sur tous les toits.
Vous vivez dans une maison, dans les Yvelines, loin de l’agitation parisienne. Le succès d’Intouchables a-t-il perturbé la tranquillité à laquelle vous tenez?
Non. Cela fait un moment que les habitants du coin me connaissent. Ils me glissent des petits mots gentils au café, à la boulangerie, dans ma boîte aux lettres, mais personne ne vient sonner à ma porte. Aucun paparazzi ne planque devant chez moi. Il n’y a rien de bandant pour eux: je vis avec la même femme depuis quatorze ans, j’emmène mes mômes à l’école… Je les intéresserais si je partais en vrille, mais dans l’immédiat, ce n’est pas le projet.
Se retrouver à la tête d’un des plus gros succès du cinéma français, n’est-ce pas comme gagner à l’Euromillions? Cela entraîne des changements dans votre quotidien…
La différence, c’est que les gagnants de l’Euromillions peuvent rester anonymes. Moi, pas. Alors oui, il y a des côtés relous, comme exposer ma femme, qui préfère rester dans l’ombre. Mais comparé à tout ce qui est bon, ce n’est pas cher payé.
Autre effet de loupe, votre absence très remarquée à l’Elysée quand Nicolas Sarkozy y invite toute l’équipe d’Intouchables…
J’ai un grand respect pour la fonction présidentielle […] J’aurais agi de la même façon pour un autre président.
Je lui ai présenté mes excuses en lui envoyant un mot avec le coffret du SAV. Ce n’était pas un pied de nez; je n’avais rien d’autre à lui offrir. J’étais sur le tournage de De l’autre côté du périph’, dont le budget est modeste. De quel droit allais-je planter 80 personnes sous prétexte que je suis invité à déjeuner à l’Elysée? J’ai un grand respect pour la fonction présidentielle, mais j’ai un boulot et la vie continue. J’aurais agi de la même façon pour un autre président. Après, chacun l’interprète comme il veut, je m’en fiche. Je ne suis prisonnier de rien. Je fais ce que je veux. Ce qui m’arrive est génial, mais cela ne modifiera en rien ma façon de vivre.
Vous a-t-on proposé d’être soutien de candidats à la présidentielle?
Oui, j’ai eu pas mal de demandes. Et je n’en ai accepté aucune. J’exprime mes orientations politiques dans mes choix artistiques. SiIntouchables est perçu comme un message d’espoir et humaniste, alors c’est gagné. Ce film-là touche plus de monde, au-delà de nos frontières. En Allemagne, par exemple, c’est un des plus gros succès au box-office. S’engager publiquement dans une voie politique, c’est une prison. J’y perdrais ma liberté. Le vote est confidentiel et doit le rester. Je suis exposé, et alors? La politique et la religion relèvent du domaine personnel. Cela ne regarde que moi et mes proches.
Un mot, quand même, sur la situation au Sénégal, dont votre père est originaire?
Elle m’inquiète. On sent poindre le soulèvement. Je n’ai pas eu le temps d’y aller depuis dix mois, mais je m’y rends régulièrement. Et, malgré la misère encore trop présente, il y avait assez peu d’abus politiques jusqu’à présent. Tout au plus quelques petites entorses que les gens acceptaient bon an mal an. Disons que la démocratie évoluait lentement mais sûrement. Et là, parce qu’un mec de 85 ans [Abdoulaye Wade] abuse ouvertement en voulant s’accrocher au pouvoir, le pays risque de partir en vrille. J’espère sincèrement me tromper. En attendant, pour le bien du pays, il ne faut pas que Wade reste.
Comment garder la tête froide quand on se retrouve troisième personnalité préférée des Français, après Yannick Noah et Zinédine Zidane [sondage effectué par Le Journal du dimanche, en janvier 2012] ?
Je commence par ne pas y croire, pensant que c’est forcément une erreur… Après, bon, je reconnais, c’est flatteur. Disons que cette place renforce mes convictions. Cette récompense, je ne l’ai pas cherchée. Je fonctionne selon mes envies, je ne calcule rien. Et puis, attendez l’année prochaine! Ce genre de choses, ça bouge vite.
Imaginons un instant que vous n’ayez pas été nommé pour le César du meilleur acteur : le soulèvement populaire était proche…
On m’a même dit que j’étais beau! Croyez-moi, mon égo a un PEL et un Codevi bien remplis.
Je n’ai pas eu besoin de l’imaginer… Je ne pensais pas être nominé, vu que je n’étais pas dans la présélection des meilleurs espoirs. J’étais persuadé que c’était mort. Je viens d’arriver dans le cinéma, j’en suis à mes débuts: alors attendre une nomination pour le César du meilleur acteur… J’avais déjà eu beaucoup: les compliments de partout, les demandes d’interviews, le sondage du JDD… On m’a même dit que j’étais beau! Croyez-moi, mon égo a un PEL et un Codevi bien remplis.
Le succès d’Intouchables pouvant être considéré comme un CDI, vos parents sont-ils enfin rassurés ?
Ils le sont un peu plus, mais pas totalement. Un film à 19 millions d’entrées, ce n’est pas un CDI, mais un CDD longue durée. AvecIntouchables, ils ont pris conscience que jouer la comédie est mon métier. Pour la première fois, ils m’ont dit que je travaillais bien, reconnaissant ainsi que c’était un travail.
Ressentez-vous une pression pour la sortie de votre prochain film, dont les entrées seront forcément comparées à celles d’Intouchables?
Non. Pour l’instant, je suis dans une fête foraine géante! Sur tous les manèges que je vais essayer, certains seront formidables, d’autres me feront gerber… Dans tous les cas, je vais m’amuser. Et surtout, je sais qu’un truc pareil ne se reproduira pas. Il faut donc que je passe à autre chose. Et quand j’aurai des coups durs, je me tournerai vers l’affiche d’Intouchables, et je me dirai que j’ai au moins vécu ça.
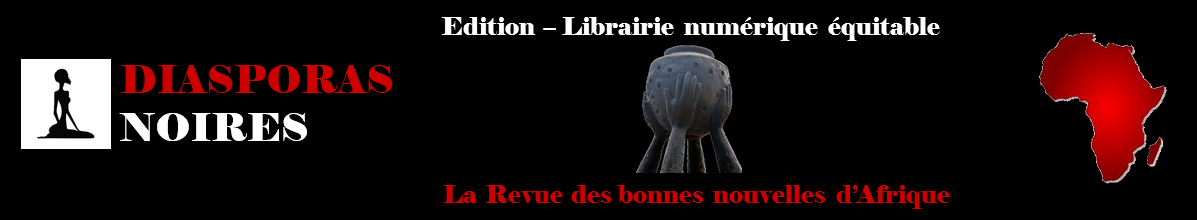


 Zoom sur l’invention de la présidente du Groupe d’initiative commune des paysannes de Bogso
Zoom sur l’invention de la présidente du Groupe d’initiative commune des paysannes de Bogso Un site répertorie tous les chercheurs algériens, détenteurs de brevets, établis à l’étranger ou en Algérie
Un site répertorie tous les chercheurs algériens, détenteurs de brevets, établis à l’étranger ou en Algérie Jelani Aliyu est originaire de la ville de Sokoto
Jelani Aliyu est originaire de la ville de Sokoto