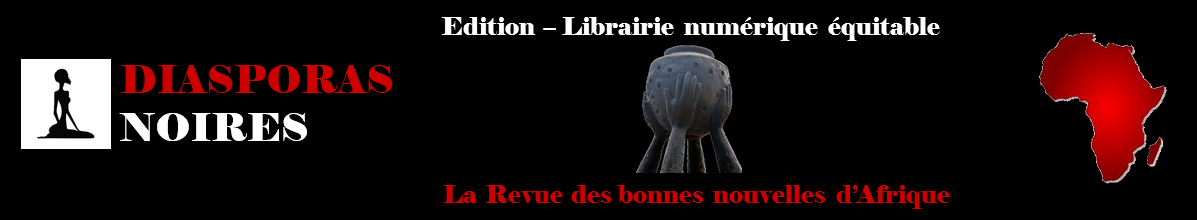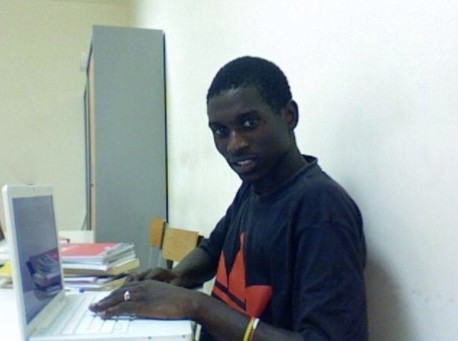Brice Lopez Grah
Master en linguistique française
NTNU (Université des Sciences et Techniques de Norvège)
Le nouchi : enjeux d’une officialisation
Le nouchi est un parler qui a vu le jour en Côte-d’Ivoire vers les années 1980 à un moment où la plupart de jeunes ivoiriens déscolarisés cherchaient un code de communication, de ralliement et d’affirmation de soi. Dans cet article, nous évoquerons les enjeux qu’il y’aurait à officialiser ce parler. En d’autres termes, nous allons répondre à la question suivante : quels sont les avantages d’une officialisation du nouchi ? Nous le ferons en décrivant le nouchi comme un parler populaire, identitaire, trans-ethnique et comme un parler de développement économique.
Dans une perspective d’aménagement linguistique, l’élaboration d’une politique de protection d’une langue est fondamentale. il ne sera pas question de proposer un plan de planification du nouchi. Plutôt, nous tenterons de repondre à la préoccupation suivante: pourquoi défendre ou promouvoir le nouchi? Pourquoi pourrait-on par exemple recommander le nouchi auprès des autorités politiques ivoiriennes?
En effet, nous partirons du principe que les langues, produit de la pratique sociale, sont au service des hommes et non pas l’inverse, et que pour décider de défendre ou de combattre une langue, il faut préalablement savoir quelle est son utilité pour ses locuteurs. En d’autres termes, nous partirons du principe que la gestion politique des langues passe par l’analyse de leurs fonctions pratiques et symboliques pour répondre à la question suivante: quel intérêt y a-t-il à ce que le parler nouchi soit officialisé? Quels sont les critères sur lesquels l’on pourrait s’appuyer pour recommander le nouchi auprès des décideurs politiques ?
1 le nouchi: un parler populaire et identitaire
L’officialisation d’une langue dans un système écolinguistique donné nécessite, très souvent, une certaine gestion du plurilinguisme. Avant d’avoir une préférence sur une langue plutôt que sur une autre, l’État doit préalablement gérer un certain nombre de situations. Louis-jean calvet évoque deux de ces situations: ″les sentiments linguistiques des locuteurs qui rentrent dans le cadre d’une gestion in vivo du plurilinguisme, et les décisions de l’État (des décisions qui sont de concert avec les hypothèses et les propositions que les linguistes font pour l’avenir des langues ou pour la gestion du plurilinguisme) qui rentrent dans le cadre d’une gestion in vitro du plurilinguisme″[1]. En d’autres termes, pour Louis-jean Calvet, avant de promouvoir ou d’officialiser une langue, l’État doit à la fois tenir compte de l’avis des spécialistes linguistiques et de l’assentiment populaire. Ainsi pour Calvet, il serait peu cohérent d’imposer à un peuple une langue dont il ne veut pas; ou alors de lui imposer une langue minoritaire s’il existe déjà une langue véhiculaire largement diffusée. Louis-jean Calvet cite par exemple le cas de la Norvège[2] qui réussit, après l’obtention de son indépendance, à résoudre sa situation linguistique compliquée en adoptant à la fois le bokmål (qui signifie littéralement la langue des livres), une langue autrefois élitiste et proche du danois (la langue de l’ancien colonisateur); et le nynorsk ( qui signifie littéralement le nouveau norvégien), une langue populaire, proche du peuple, qui sera standardisée en partant des différents dialectes du pays. Au fait, l’adoption du bokmål et du nynorsk, deux langues officielles qui coexistent encore aujourd’hui, traduisait la volonté du gouvernement de satisfaire à la fois ses stratégies politiques et les aspirations du peuple souverain.
Partant de cet exemple norvégien, il serait possible de croire, pour paraphraser Alain Laurent Abia Aboa, en l’avenir du nouchi[3]. Car le nouchi est de nos jours la langue populaire et la langue la plus utilisée en Côte-d’Ivoire. Laurent Abia Aboa le confirme:
L’apparition du nouchi comme variété la plus récente du français ivoirien a quelque peu modifié la donne linguistique en Côte d’Ivoire. Utilisé au début comme code secret par les jeunes de la rue, il a vite été adopté par les élèves et étudiants, ce qui a réduit son caractère cryptique. Aujourd’hui, le nouchi s’étend, à des degrés divers, à toutes les couches de la société. Ce qui fait penser que le phénomène nouchi pourrait bien avoir un avenir en Côte d’Ivoire [4].
Le nouchi est la langue véhiculaire par excellence en Côte-d’Ivoire; celle qui suscite un fort engouement populaire. Elle est revendiquée par les ivoiriens qui sont convaincus d’affirmer leur identité, leur esprit créateur et leur volonté de liberté à travers elle. Et l’augmentation constante du nombre de jeunes[5] accroît chaque jour et de façon exponentielle le nombre de locuteurs du nouchi. On peut donc comprendre pourquoi Kouadio[6] pense que le nouchi se veut un signum social; et que ses locuteurs cherchent à afficher leur appartenance à un groupe; qu’ils veulent faire passer des messages codifiés à travers un langage secret[7]. On peut aussi comprendre Boutin qui dit que le nouchi n’est pas resté longtemps la langue secrète d’un milieu particulier puisqu’il s’est vite répandu dans les conversations des élèves et étudiants.[8]
En fait, il est possible d’affirmer que la prévision de Louis-jean Calvet selon laquelle le nouchi permettrait d’imaginer l’avenir de la langue française en Côte d’Ivoire et représenterait la langue identitaire[9], semble de plus en plus effective. Car, pour reprendre les propos de Laurent Abia Aboa, lorsque les locuteurs d’une variété différente du standard prennent conscience des différences qui existent entre leur variété et la langue standard et s’y reconnaissent, ce n’est plus qu’une question de temps jusqu’à ce que ces locuteurs demandent la reconnaissance officielle de la variété et en soutiennent le développement [10].
Au fait, le nouchi ne remplit pas que la fonction pragmatique d’une langue véhiculaire; il se développe aussi de plus en plus dans un contexte social dans lequel les locuteurs se trouvent à la recherche d’une langue traduisant leur identité. La ruée vers le nouchi peut être interprétée comme une volonté d’effacer les stigmates de la colonisation, notamment la promotion de la langue française depuis 1883 par l’Alliance française dont l’objectif premier était le rayonnement du français dans les colonies et, accessoirement, à l’étranger. Comme le témoigne cet extrait du discours de Jean Jaures prononcé lors d’une conférence en 1884:
L’Alliance a bien raison de songer avant tout à la diffusion de notre langue: nos colonies ne seront françaises d’intelligence et de cœur que quand elles comprendront un peu le français […]. Pour la France […] la langue est l’instrument nécessaire de la colonisation »[11].
Aujourd’hui, le nouchi donne à voir une tendance évolutive qui pourrait conduire à une nouvelle gestion du plurilinguisme en Côte-d’ivoire.
Outre l’assentiment populaire, le nouchi peut être officialisé parce qu’il est trans-ethnique.
2. le nouchi: un parler trans-ethnique
Dans une situation de plurilinguisme, un État peut parfois être amené à promouvoir une langue dominée, ou au contraire, à retirer à la langue dominante le statut dont elle jouissait. L’État peut décider d’une telle intervention pour juguler des polémiques et des conflits ethniques. On l’a vu, à l’aube des indépendances, dans plusieurs pays francophones de l’Afrique subsaharienne, notamment en Côte- d’Ivoire, où les autorités considérèrent la langue française comme une langue de cohésion qui primerait sur les langues locales et étoufferait tout sentiment de division; comme une langue qui fermenterait l’unité nationale. L’extrait du discours du président de l’Assemblée nationale d’alors, Philippe-Grégoire yacé, le témoigne:
Je dois toutefois à la vérité de dire qu’en ce qui concerne mon pays, l’adoption du français par l’article premier de notre constitution a été sans doute l’un des facteurs d’unité qui ont favorisé l’aboutissement heureux et si rapide de l’œuvre de construction nationale dont son excellence le Président Felix Houphouët Boigny avait fait un des premiers thèmes de son action. Le français librement accepté par nous, a été un facteur de cohésion à l’intérieur de la Côte d’Ivoire où il a favorisé le regroupement de nos quelques cent ethnies[12]
Outre les pays africains du sud du sahara, l’Indonésie[13] a vécu la même planification linguistique après son indépendance au milieu des années 1940. En effet, avant son indépendance vers 1940, la langue véhiculaire la plus parlée en Indonésie était le javanais. À côté du javanais, deux cents parlers différents regroupés en dix-sept ensembles dialectaux coexistaient. Cependant, lorsque l’Indonésie obtint son indépendance, il décida d’adopter comme langue nationale le malais, une langue véhiculaire qui était principalement utilisée dans les ports et sur les marchés.
Au fait, le choix du malais avait comme avantage de mettre en fonction officielle une langue neutre, dont personne ne pouvait se revendiquer. Une langue qui permettait de faire l’économie des problèmes ethniques. L’État donna au malais, rebaptisé bahasa indonesia (langue indonésienne) un vocabulaire adéquat à ses nouvelles fonctions en choisissant en priorité les mots existant déjà en malais, des mots venant des autres langues locales de l’archipel, des langues asiatiques et des langues européennes, s’ils n’en existaient pas en malais.
Les expériences indonésienne et africaine citées supra peuvent de nos jours s’appliquer en Côte-d’Ivoire en faveur du nouchi qui est un parler trans-ethnique. A la réalité, aujourd’hui en Côte-d’Ivoire, le sentiment d’insécurité linguistique (la guerre entre la norme standard du français et les normes endogènes issues de la norme standard) qui prévalait à la naissance du nouchi ne peut plus être défini uniquement, pour paraphraser J. Kouadio N’Guessan, comme une manifestation sous forme de dérangement, de gêne, de perplexité, de doute devant la difficulté de parler correctement la langue française [14]. Mais plutôt ce sentiment pourrait être compris comme un parti pris délibéré de refuser de se plier aux dictats d’une norme française devenue évanescente que l’école n’arrive plus ni à reproduire ni à dẻfendre.
En effet pour de nombreux ivoiriens, majoritairement jeunes, la langue officielle, le français, est celle qui permet l’accès à la vie publique et à des postes importants. Seulement, cette langue ne peut pas, selon eux, répondre aux besoins identitaires des Ivoiriens qui voient leur identité mieux représentée par les langues ivoiriennes. Or la plupart, sinon toutes les langues ivoiriennes locales n’ont pas d’utilité dans la vie publique parce qu’elles n’ont pas de statut officiel. Plus encore, la majorité de ces langues ne peuvent servir de moyen de communication inter-ethnique. Le parler local qui réunirait à la fois les fonctions de langue officielle et de langue inter-ethnique est donc toujours recherché par les Ivoiriens et pourrait être trouvé dans le nouchi.
L’État ivoirien pourrait donc promouvoir le nouchi pour renforcer et consolider la cohésion et la solidarité nationale. Car le nouchi, à l’instar du bahasa indonesia (langue indonésienne), a un vocabulaire adéquat qui puise dans la plupart des langues locales et étrangères de la Côte-d’Ivoire: le français, l’anglais, l’espagnol, l’allemand, le dioula, le bété, etc.
Au fait, L’État ivoirien gagnerait à faire confiance au nouchi; car c’est la seule sociolecte qui brise les barrières sociales et permet une intercompréhension plus grande dans une population marquée par une multiplicité d’ethnies et de langues. C’est la seule sociolecte qui rompt les barrières tribales et les particularismes; et qui met les ivoiriens au même pied d’égalité.
La majorité, sinon tous les ivoiriens peuvent la comprendre sans même l’apprendre. C’est ce qui explique pourquoi les milieux artistique, commercial et politique en font leur support publicitaire. On retrouve le nouchi dans les graffitis qui recouvrent les murs et les parois des autobus à Abidjan. On le retrouve dans la musique zouglou, musique ivoirienne par excellence. On a retrouvé le nouchi chez les trois ténors de la politique ivoirienne que sont Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié, lors des campagnes électorales. Les trois candidats à l’élection présidentielle d’octobre 2010 utilisaient quelques mots du nouchi dans leurs propos. Laurent Gbagbo disait de ses adversaires politiques qu’ils étaient flêkê-flêkê[15] et qu’il allait les gbôlô. Ce qui signifie que tous ses adversaires politiques étaient faibles, et qu’il allait les battre.
En somme, le nouchi est un parler trans-ethnique parce qu’il utilise, en plus de ses propres mots, des mots issus de tous les parlers de Côte-d’Ivoire. En cela, il rallie et rassemble toutes les sensibilités. Les politiciens et les hommes d’affaires s’en servent pour être compris par tous, pour aggrandir leurs audiences. Ainsi, le nouchi peut tout aussi être considéré comme une langue de développement.
3 Le nouchi: un parler de développement économique
Outre les facteurs démographiques, linguistiques et culturels, des facteurs économiques tels que les échanges commerciaux peuvent aussi justifier et motiver l’officialisation du nouchi.
En effet, dans les situations de plurilinguisme, les États peuvent s’appuyer sur la rentabilité d’une langue pour décider de sa planification. Cela fut le cas en Indonésie et en Tanzanie[16].
Après l’indépendance, l’État indonésien décida d’adopter le malais pour deux principales raisons. D’abord, parce que le malais était la langue de personne, c’est-à-dire une langue qui permettait de faire l’économie de polémiques et de conflits ethniques. Ensuite, parce que le malais, au départ, était essentiellement une langue de commerce utilisée dans les ports et sur les marchés. Ainsi, l’on peut comprendre que le choix du malais au détriment du javanais (la langue la plus parlée dans l’archipel avant les indépendances) avait tout aussi des enjeux économiques. Car le malais allait jouer un grand rôle en matière de dẻveloppement du pays. En tant que langue transfrontalière, c’était un élément clé pour aider les citoyens (les acteurs de l’économie) à trouver leur propre solution aux défis qu’ils rencontraient dans leur vie.
Après son indépendance en 1961, le Tanganika, qui deviendra la Tanzanie en 1964, officialisa progressivement le swahili dans un contexte où le pays, géré en anglais, comptait plus de cent langues locales différentes. La promotion du swahili vers les années 1964, aux dépens de l’anglais et des langues vernaculaires, par le président Julius Nyerere, fut facilitée par un certain nombre de facteurs[17] parmi lesquels les facteurs économiques. Car depuis l’époque coloniale, le swahili est une langue véhiculaire et transfrontalière qui s’est dẻveloppée dans le commerce, le long des côtes-Est de l’Afrique, et vers l’intérieur du continent. Et au moment de l’indépendance du Tanganika, il servait de langue véhiculaire sur les marchés et dans les ports. Son officialisation fut donc un moyen pour le dẻveloppement du PIB (Produit intẻrieur brut) du pays. L’État était convaincu qu’en employant le swahili (une langue véhiculaire parlée dans la sous-région Est africaine) dans leurs activités commerciales quotidiennes, les populations, dans leur majorité, allaient trouver des solutions aux défis auxquels elles faisaient face.
À l’instar du malais et du swahili, le nouchi a une plus-value économique. Fortement basé sur le français, il utilise aussi des mots anglais, espagnols, allemands, entre autres. On note par ailleurs une forte dominance du dioula et du baoulé, ethnies les plus représentées sur les marchés. Le nouchi s’impose donc à une grande majorité de la population urbaine, notamment dans les secteurs d’activité comme le transport routier et le commerce. Voici, à titre illustratif, quelques mots et expressions nouchi que l’on retrouve dans le secteur du commerce urbain, inter-urbain et transfrontalier (La Côte-d’Ivoire et le Burkina Faso; la Côte-d’Ivoire et la Guinée; la Côte-d’Ivoire et le Mali; la Côte-d’Ivoire et le Sẻnẻgal; la Côte-d’Ivoire et la Mauritanie) :
Gbaka : Mini-car de transport en commun de 18 places; Woyo : Taxi compteur; Wôro-wôro: taxi communal; Môgô : un passage ou un client; Frappeur: Chauffeur ou Conducteur; Balanceur: un Apprenti-chauffeur ou un aide du conducteur; Djoulatchè : un propriétaire du véhicule; Chawo : le chef , le patron du véhicule.[18]
L’État ivoirien peut donc se servir de la progression du nouchi sur le commerce et le marché de l’emploi (surtout informel) pour l’officialiser ; c’est-à-dire l’imposer en l’impliquant dans le processus de l’apprentissage, dans les médias et dans l’administration.
Conclusion
De notre analyse où il éait question d’indiquer quelques enjeux d’une officialisation du nouchi, il ressort qu’un certain nombre de critères socio-linguistique et socio-économique pourraient plaider en faveur de la planification et de l’officialisation du nouchi. Nous avons vu par exemple que le nouchi peut être décrit comme une langue trans-ethnique capable de promouvoir et de consolider la cohésion nationale. Il peut être décrit comme une sociolecte capable de faire rompre les barrières tribales et les particularismes en permettant une intercompréhension plus grande dans une population marquée par une multiplicité d’ethnies et de langues. Nous avons vu en outre que c’est un parler qui s’impose dans les secteurs d’activité comme le transport routier et le commerce. L’évocation de ces données a permis de réaliser combien il serait nécessaire de standardiser et de diffuser le nouchi qui devient de plus en plus incontournable pour une grande majorité d’ivoiriens.
Bibliographie
Abia Aboa, A.L ″Le nouchi a-t-il un avenir?″, Revue Sudlangues, www.ltml.ci/files/…/Jean-BaptisteATSeNCHO.pdf
BARKO, I, ″ L’Alliance française : les années Foncin (1883-1914). Contexte, naissance, mutations″, L’Enseignement et la diffusion du français dans l’empire colonial français. 1815-1962, Documents, Sihfles, 2000.
Boutin, B. Description de la variation : études transformationnelles des phrases du français de Côte d’Ivoire, thèse de Doctorat, Université de Grenoble III, 2002
Calvet, L-J, Les politiques linguistiques, Paris, PUF, 1996
Calvet, L.J, ″Le nouchi, langue identitaire ivoirienne ? ″, in Diagonales 42, 1997
Dictionnaire Le petit nouchi, www.nouchi.com
Kouadio N’guessan, J, ″Le nouchi abidjanais, naissance d’un argot ou mode linguistique passagère ?″, in Gouaini/Thiam (éds.), Des langues et des villes, Paris, ACCT/Didier Erudition, 1990.
Leclerc, J, ″Côte d’Ivoire – Les religions dans L’aménagement linguistique dans le monde″, Québec, TLFQ, Université Laval, 28 oct. 2002, [http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/afrique/cotiv.htm]
[2] Louis-jean Calvet, Les politiques linguistiques, Paris, PUF, 1996,p.84
[3] A.L, Abia Aboa, ″Le nouchi a-t-il un avenir?″, Revue Sudlangues, www.ltml.ci/files/…/Jean-BaptisteATSeNCHO.pdf
[5] En 1998 déjà, sur une population totale estimée à 15 366 672 habitants, on dénombrait 6 529 138 urbains, soit 42%. Et parmi cette population urbanisée, la proportion des jeunes est assez importante, de l’ordre de 50%. ( voir l’article de Laurent Abia ABOA (Le nouchi a-t-il un avenir?)
[6] J. Kouadio N’guessan, ″Le nouchi abidjanais, naissance d’un argot ou mode linguistique passagère ?″, in Gouaini/Thiam (éds.), Des langues et des villes, Paris, ACCT/Didier Erudition, 1990, p. 373-383.
[8] B. Boutin, Description de la variation : études transformationnelles des phrases du français de Côte d’Ivoire, thèse de Doctorat, Université de Grenoble III, 2002
[9] L.j.Calvet, ″Le nouchi, langue identitaire ivoirienne ? ″, in Diagonales 42, 1997
[10] L. Abia Aboa, ″Le nouchi a-t-il un avenir?″ Ibid
[11] I BARKO., ″ L’Alliance française : les années Foncin (1883-1914). Contexte, naissance, mutations″, L’Enseignement et la diffusion du français dans l’empire colonial français. 1815-1962, Documents, Sihfles, 2000, p 94
[12] J. Leclerc ″Côte d’Ivoire – Les religions dans L’aménagement linguistique dans le monde″, Québec, TLFQ, Université Laval, 28 oct. 2002, [http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/afrique/cotiv.htm]
[13] L.J.Calvet, Les Politiques linguistiques, Paris, PUF, 1996, p.92
[14] J. Kouadio N’guessan, ″Le nouchi abidjanais, naissance d’un argot ou mode linguistique passagère ?″, in Gouaini/Thiam (éds.), Des langues et des villes, Paris, ACCT/Didier Erudition, 1990, p. 373-383.
[15] L. Gbagbo, cité par Jérémie Kouadio N’guessan, Ibid
[16] J.L. Calvet, Les Politiques libnguistiques, Paris, PUF, 1996
[17] Les facteurs historiques: le swahili était, au moment de l’indépendance, depuis longtemps écrite et utilisée dans l’administration locale. Les facteurs symboliques: le swahili était symboliquement perçu comme la langue de l’indépendance. Les facteurs geo-stratégiques: le swahili n’était la langue de personne. Sa promotion ne pouvait pas être assimilée à la prise de pouvoir d’un groupe ethnique sur les autres. (Louis-jean Calvet, Les politiques linguistiques . p.91)
De son vrai nom Alioune Badara Thiam, le rappeur et producteur de musique Akon, vient d’achever sa tournée en Afrique après avoir visité une dizaine de pays pour présenter son projet ? d’électrification rurale : Akon lighting africa. Actuellement au Sénégal, après avoir effectué une tournée africaine, il présente à Afrik.com son projet ? Contacté par téléphone, c’est en wolof (langue la plus parlée au Sénégal) qu’il nous a accordé cet entretien. Interview.
 Loin du faste et des paillettes, contre toute attente, c’est un Akon très timide, voire réservé, à la voix douce et posée, qui se révèle au téléphone. On connait surtout Akon ou Alioune Badara Thiam dans l’univers de la musique, notamment du Rap et du hip-hop. Mais derrière sa corde musicale, c’est aussi un grand entrepreneur, qui souhaite apporter sa contribution au développement de l’Afrique. À travers son projet Akon ligthting Africa, il souhaite électrifier le continent grâce notamment à l’énergie solaire. Le célèbre rappeur qui s’est fait un nom aux États-Unis, mais aussi à l’international, revient tout juste de sa tournée d’une dizaine de pays africains ? Il l’a entamé le 24 juillet lors du Global Entrepreneurship Summit qui a traversé le Kenya, le Rwanda, le Congo-Brazzaville, le Nigeria, le Niger et le Bénin échangeant avec des agences locales en charge de l’électrification rurale pour identifier les possibilités de déploiement des solutions solaires. Une tournée qu’il a achevée au Bénin pour poser les premiers jalons de son initiative. Il était accompagné de ses principaux partenaires l’entrepreneur Thione Niang, et de Samba Bathily, PDG de la société Solektra international. Au Bénin, la société a déjà installé 1 500 lampadaires solaires et 2 200 kits solaires, suite à un appel d’offres remporté, il y a quelques mois ciblant un total de 124 localités.
Loin du faste et des paillettes, contre toute attente, c’est un Akon très timide, voire réservé, à la voix douce et posée, qui se révèle au téléphone. On connait surtout Akon ou Alioune Badara Thiam dans l’univers de la musique, notamment du Rap et du hip-hop. Mais derrière sa corde musicale, c’est aussi un grand entrepreneur, qui souhaite apporter sa contribution au développement de l’Afrique. À travers son projet Akon ligthting Africa, il souhaite électrifier le continent grâce notamment à l’énergie solaire. Le célèbre rappeur qui s’est fait un nom aux États-Unis, mais aussi à l’international, revient tout juste de sa tournée d’une dizaine de pays africains ? Il l’a entamé le 24 juillet lors du Global Entrepreneurship Summit qui a traversé le Kenya, le Rwanda, le Congo-Brazzaville, le Nigeria, le Niger et le Bénin échangeant avec des agences locales en charge de l’électrification rurale pour identifier les possibilités de déploiement des solutions solaires. Une tournée qu’il a achevée au Bénin pour poser les premiers jalons de son initiative. Il était accompagné de ses principaux partenaires l’entrepreneur Thione Niang, et de Samba Bathily, PDG de la société Solektra international. Au Bénin, la société a déjà installé 1 500 lampadaires solaires et 2 200 kits solaires, suite à un appel d’offres remporté, il y a quelques mois ciblant un total de 124 localités.